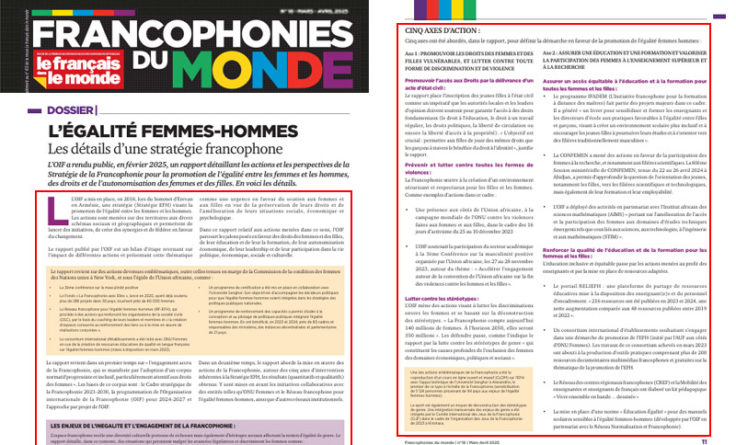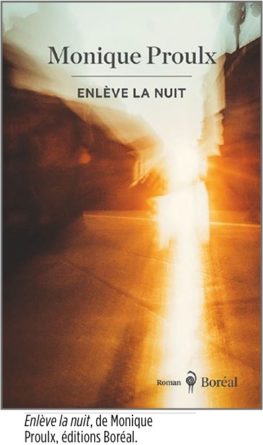 Enlève la nuit de la romancière canadienne Monique Proulx publié aux Editions du Boréal a remporté le Prix des Cinq continents 2022 créé et porté par l’Organisation Internationale de la Francophonie. Il fait partie des dix livres en lice pour cette 21ème édition et qui ont été sélectionnés parmi 188 candidatures.
Enlève la nuit de la romancière canadienne Monique Proulx publié aux Editions du Boréal a remporté le Prix des Cinq continents 2022 créé et porté par l’Organisation Internationale de la Francophonie. Il fait partie des dix livres en lice pour cette 21ème édition et qui ont été sélectionnés parmi 188 candidatures.
Ce roman a été plébiscité par un jury présidé par l’écrivaine franco-égyptienne Paula Jacques et composé de quinze auteurs issus de différents pays francophones.
Enlève la nuit qui a été salué pour la singularité de sa langue et l’originalité de son sujet est le sixième roman de Monique Proulx. A travers son personnage juif hassidique qui se rebelle contre les règles de sa communauté, elle y relate la liberté conquise au fil des affrontements et acquise au prix de la solitude. Interview
- Votre livre Enlève la nuit s’est distingué par rapport aux neuf autres romans sélectionnés. Comment cette victoire a-t-elle été accueillie (par vous, par votre entourage, au Canada) ?
Surprise et joie.
Bien sûr, lorsqu’on peaufine ses romans pendant cinq ans et qu’on tente d’y mettre le meilleur de soi-même, il y a cette certitude du travail accompli. Mais atteindre d’autres francophones, à l’extérieur de la bulle québécoise, faire vibrer des sensibilités qui ne connaissent pas notre paysage social et nos particularités langagières procure une grande émotion. Il y a donc une universalité dans l’écriture et dans la création, il n’y a donc pas de frontières géographiques quand on touche à l’essence, c’est ce qu’il faut se rappeler sans cesse quand on écrit dans un petit pays comme le Québec.
Je suis convaincue que les neuf autres auteurs sélectionnés avaient, tous, le potentiel pour remporter ce prix, je les remercie d’apporter à la grande architecture francophone leur voix et leur talent singuliers.
J’ai senti, dans les médias québécois et autour de moi, cette même fierté, ce même ravissement, que l’une d’entre nous se retrouve couronnée du Prix des Cinq continents de la Francophonie. Nous travaillons si fort, au Québec, pour que notre langue survive et fleurisse au sein de la mer anglophone de l’Amérique du Nord.
- Enlève la nuit retrace le parcours d’un juif hassidique qui rompt avec sa communauté, ne s’épanouissant pas dans son rigorisme et son autarcie. Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Ce sont sans doute les personnages qui choisissent les écrivains, et non l’inverse. Markus avait déjà fait une courte apparition dans mon roman précédent (Ce qu’il reste de moi) et c’est comme s’il ne m’avait pas laissé le choix, comme s’il m’avait dit: Ne m’abandonne pas comme ça sur le trottoir d’une ville hostile, raconte mon histoire!
Je crois vraiment qu’il n’y a pas plus grande quête humaine que celle de découvrir qui on est, sous le fatras des conditionnements accumulés. J’avais la chance, avec Markus, de m’abandonner à cette quête, de suivre un personnage complètement neuf, enfui d’une communauté très fermée, qui débarque dans le Frais Monde (comme il l’appelle) comme un nouveau-né de 20 ans, plus étranger et perdu qu’un immigrant qui, lui, connaît au moins les clés de la modernité.
Il faut dire que j’habite depuis trente ans dans le quartier hassidique orthodoxe de Montréal, que je suis depuis toujours fascinée par leur retrait du monde et leur refus du modernisme, et par la résilience de ceux d’entre eux qui ont osé s’enfuir de ce milieu très étanche.
Markus est donc en mode survie et apprentissage total. Quand on n’a rien, qu’on ne sait rien, il ne nous reste qu’à puiser dans nos forces vives, qu’à retourner sans cesse à ce noyau dur en nous, le meilleur guide qu’on puisse trouver. Et puis, quand on ne sait rien, comme Markus, qu’on n’a aucune idée préconçue, on devient un observateur impeccable de la société dite libre, on perçoit le côté toxique ou intègre des êtres malgré les apparences. Il y a une grande puissance, dans cette virginité-là, et bien sûr, une immense solitude. Et une forme de résistance héroïque: s’adapter, oui, rompre sa solitude, oui, mais pas à n’importe quel prix. Pas au prix de perdre ce qu’il y a de meilleur en nous.
- Vous en êtes à votre neuvième prix littéraire. Qu’est-ce qui fait le succès de vos livres ?
Le succès. Les prix.
Tout est relatif, en ce domaine, et tout est aléatoire. Il y a d’excellents livres qui ne sont pas couronnés. D’autres qui ne rencontrent jamais l’assentiment public. J’accepte tout ce qui m’arrive de bon, et je ne déplore pas ce qui me manque. Je dis souvent, en manière de blague: Sommes-nous des chiens, pour avoir besoin de récompenses?…
Les lecteurs qui m’aiment et me suivent sont sensibles, je crois, au fait que si mes livres racontent des histoires et fouillent la moelle des personnages, ils sont surtout affaire de beauté et de musique.
Je crois que la beauté peut sauver le monde et réenchanter le lecteur, que tout concorde à désespérer.
Je crois que les écrivains doivent donner de la nourriture à l’âme et au cœur, mots tabous dans notre contemporanéité cynique.
- Quel rapport entretenez-vous avec la langue française ?
Ah, la langue française.
La langue tout court, comme dit Markus, qui est un néophyte en français, mais qui, à force de jouer avec les mots et de les triturer, deviendra un écrivain –un écrivant – sous nos yeux.
Je dois dire que la langue est le personnage principal de mes romans. La langue est la glaise avec laquelle je tente de sculpter de la beauté, de transmettre de la beauté. Les romans tels que je les conçois s’arc-boutent d’abord sur l’écriture, même s’ils racontent une histoire. Je ne peux véritablement avancer dans un roman tant que je n’en ai pas trouvé la forme, la musique qui en sous-tendra l’univers particulier.
Chaque roman commande sa propre musique, même si un écrivain ne dispose pas de milliers de couleurs dans sa palette. Quelques variations suffisent, un rouge plus assumé ici, un noir léger là, de l’humour, de la poésie, de la réalité magique… Tout est possible.
J’ai un rapport à la fois jouissif et douloureux avec cette langue qui est mienne, parce que j’aime en exalter les virtuosités, et qu’elle ne se laisse pas toujours faire. J’aime brasser les mots, leur faire rendre leur jus et leur sonorité, m’éloigner de la facilité avec laquelle on a tendance à les disposer sagement et utilitairement. Le français est un instrument de musique fabuleux, et toute une vie de pratique ne parviendra pas à en épuiser les nuances, alors pourquoi être si paresseux?…
En ce sens, le personnage de Markus, nouveau-né en français aussi bien qu’en toutes choses, était pour moi un véritable cadeau. Puisqu’il est le narrateur du roman, j’ai pu m’épivarder* (ndlr : le verbe épivarder est principalement utilisé au Québec. Il signifie s’amuser) avec lui, inventer des mots, les travestir, écrire avec une inventivité jubilatoire. On s’est bien amusés, tous les deux.
- Quel regard portez-vous sur le paysage littéraire francophone ?
En toute honnêteté, je peux parler surtout du paysage littéraire québécois, que je connais bien plus que les autres. Comme les sociétés se répondent et se complètent, j’imagine qu’il se passe peut-être le même phénomène dans les autres francophonies:
il y a, en ce moment, une explosion incroyable de talents et de voix nouvelles.
Pas une saison ne se passe sans que deux ou trois livres choc n’atterrissent dans le paysage littéraire -et encore ce sont seulement ceux que les médias ou les réseaux ont retenus.
On assiste à une sorte de renaissance du roman, peut-être à ce qu’on appellera plus tard un âge d’or. Bien sûr, plusieurs de ces œuvres sont de l’autofiction, une forme de plus en plus goûtée, et de plus en plus pratiquée, avec entre autres les expériences migrantes ou LGBTQuiennes qui nous emmènent en terre inconnue. Mais beaucoup d’auteurs nouveaux explorent la fiction et l’imaginaire, marqués comme ils le sont par les problématiques complexes dans lesquelles notre monde se débat.
Dans ces voix nouvelles, il y a beaucoup de désespoir transcendé -c’est ce que l’art et l’écriture savent mieux faire, au fond.
Même si les prophètes du virtuel ont déclaré obsolètes le livre et le roman, les livres se multiplient. Même si l’avenir de l’univers est terriblement inquiétant, et parce qu’il est terriblement inquiétant justement, des voix nombreuses se lèvent pour proclamer la force de la vie.
Je trouve ça beau et réjouissant.
- A travers vos créations, que voudriez-vous ajouter à ce paysage littéraire francophone ?
 Je ne veux surtout pas ajouter à l’anecdotisme et au divertissement. Il me semble que nos sociétés ne font que ça, se divertir, comme si c’était la forme la plus efficace de traverser l’existence. À force de se divertir, c’est-à-dire de fuir, on forge des êtres immatures qui ne cherchent de réponse qu’à l’extérieur d’eux-mêmes et qui ont perdu toute confiance dans leurs ressources intérieures.
Je ne veux surtout pas ajouter à l’anecdotisme et au divertissement. Il me semble que nos sociétés ne font que ça, se divertir, comme si c’était la forme la plus efficace de traverser l’existence. À force de se divertir, c’est-à-dire de fuir, on forge des êtres immatures qui ne cherchent de réponse qu’à l’extérieur d’eux-mêmes et qui ont perdu toute confiance dans leurs ressources intérieures.
Je crois que les écrivains qui y consentent ont la mission de renverser la vapeur, de ramener l’attention du lecteur dans ce vaste espace de liberté qui gît en lui, comme un trésor inconnu.
Je crois vraiment que les livres peuvent rendre meilleurs.
Un livre réussi chamboule, transporte, galvanise celui qui le lit, lui transmet une flamme qui le fera créer à son tour.
« Un livre réussi est celui qui assassine le lecteur avant de le ressusciter », a dit Christian Bobin, dont la voix lumineuse me manque déjà.
J’essaie d’écrire des livres réussis.