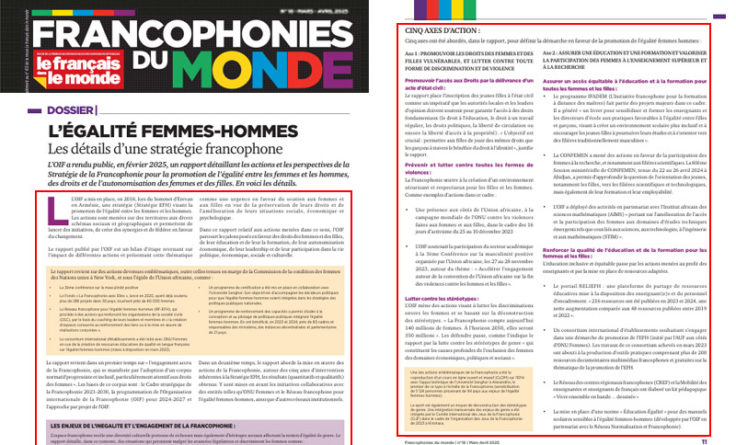En Afrique, l’exploitation du coton et le déploiement du secteur textile ne favorisent pas, comme il le faudrait, l’émergence du « fabriqué en Afrique ». Pourtant, de la récolte au tissage et à la confection, maîtriser la filière constitue un rêve à la portée du continent.
 Considéré comme l’or blanc de l’Afrique, le coton est une des richesses de plusieurs pays du continent. C’est au Bénin et au Mali que la production cotonnière atteint les chiffres les plus importants. Au Mali, la culture du coton occupe plus de 650 000 hectares et fait travailler plus de 162 000 personnes. La saison a lieu entre mai et octobre pour la production et octobre à fin mars pour la récolte. Le coton rapporte au Mali plus de 20 % de ses recettes d’exportation et représente plus de 15 % du PIB national. Le secteur du coton fait vivre environ 5 millions de Maliens.
Considéré comme l’or blanc de l’Afrique, le coton est une des richesses de plusieurs pays du continent. C’est au Bénin et au Mali que la production cotonnière atteint les chiffres les plus importants. Au Mali, la culture du coton occupe plus de 650 000 hectares et fait travailler plus de 162 000 personnes. La saison a lieu entre mai et octobre pour la production et octobre à fin mars pour la récolte. Le coton rapporte au Mali plus de 20 % de ses recettes d’exportation et représente plus de 15 % du PIB national. Le secteur du coton fait vivre environ 5 millions de Maliens.
Mais ce secteur est en crise à l’échelle internationale, et ses performances ont été impactées négativement par un fléchissement mondial de la demande. Le Mali a ainsi connu une baisse de la production, et les surfaces consacrées au coton ont diminué de plus de moitié. La crise du coton est directement liée à celle due à la pandémie ainsi qu’à la baisse des chiffres du secteur textile au niveau international. Autre baisse impactantee, celle du cours du pétrole, qui a favorisé l’intérêt pour les fibres synthétiques. Au Mali, le stock d’invendus s’est ainsi élevé à 400 000 balles de coton. Sans évoquer le fait que l’annonce de la diminution du prix d’achat garanti par l’État a poussé de nombreux producteurs maliens à opter pour d’autres cultures.
Avec une production de plus de 700 000 tonnes par an, plus élevée que celle du Mali depuis 2018, un autre pays s’impose dans la cartographie africaine du coton : le Bénin. Cette ascension a pu se faire grâce à un nombre de décisions visant à encourager et protéger les producteurs mais aussi grâce à l’industrialisation du secteur. Cela est passé aussi par l’amélioration des routes et la réhabilitation des chemins ruraux afin de désenclaver les bassins de production et de faciliter le transport des marchandises. Par ailleurs, au Bénin, le montant du prix d’achat est fixé à un taux plus élevé qu’ailleurs en Afrique. Avec pour résultat d’encourager les producteurs et de maintenir le pays à sa place de leader africain malgré le contexte de crise.
Le rôle économique de ce secteur est important surtout en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale où le coton fait vivre une population rurale et améliore le revenu de nombreux pays, notamment le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, qui se positionnent eux aussi comme des acteurs majeurs de la filière du coton en Afrique et dans le monde.
Le textile africain à l’ombre du géant chinois
Le coton participe à la hausse des recettes d’exportation de plusieurs pays. Mais la filière représente aussi un manque à gagner important, compte tenu du faible pourcentage de coton transformé sur place par rapport à celui exporté brut. En effet, seule l’industrie textile est susceptible de dynamiser la relation entre la production de coton et les potentialités des grands marchés de la confection. À défaut, le coton africain devient principalement une marchandise d’export alors qu’il pourrait habiller la population du continent.
Le paradoxe suit son cours : les marchés africains sont ainsi inondés de tissus provenant de Chine, souvent des copies d’origine africaine. Favorisés par des prix attractifs, ces marchandises suppléent les produits du continent et ralentissent la fabrication locale jusqu’à l’étouffer.
Le géant chinois, qui a longtemps accompagné le secteur textile en Afrique subsaharienne, multiplie depuis quelques années les investissements dans le secteur de la transformation du coton et de la confection sur le continent, ce qui a donné naissance à de nombreuses usines, notamment dans des pays comme la Tanzanie et surtout l’Éthiopie, devenue un nouvel eldorado pour certaines marques en quête de main-d’oeuvre qualifiée à bas coûts.
Des dizaines de projets de parcs textiles ont ainsi été lancés en partenariat avec la Chine. Cela a certes permis de stimuler le marché économique africain, mais de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer la situation et les conditions de travail des ouvriers locaux que cachent ces nouvelles infrastructures.
Malgré toutes les critiques, ce nouveau hub textile de l’Afrique a pu grâce à ce type de partenariats instaurer et imposer le made in Ethiopia. Une revanche sûrement pour une population africaine en quête de reconnaissance dans un domaine qu’elle a longtemps maîtrisé et affectionné : l’étoffe et la mode.
Privilégier les produits locaux
La production textile est ancrée dans de nombreuses cultures d’Afrique, le savoir-faire existant depuis des décennies, la matière première présente en quantité. Mais le made in Africa peine à décoller à l’international et a du mal à trouver sa place localement.
En dehors de la problématique chinoise, le textile africain est en effet concurrencé par le marché des vêtements de seconde main provenant d’Europe et des États-Unis, moins coûteux que lorsqu’il s’agit de s’habiller en coton africain. Au fil des années, ce secteur informel étrangle de plus en plus celui du textile en Afrique.
Afin de permettre à l’Afrique de rayonner par ses propres créations et sa propre production, plusieurs experts appellent à préserver et à encourager le secteur. Les consommateurs sont incités à privilégier les produits locaux malgré la rude concurrence des prix avec les produits d’importation, pour que l’Afrique qui habille le monde par son coton, cesse de s’habiller exclusivement en made in China ou en friperie !
Les designers sont également invités à préserver les techniques ancestrales et à mettre en avant l’authenticité du patrimoine africain. De nombreux créateurs ont commencé, dans ce contexte, à lutter contre la forme stéréotypée de la mode ethnique et à valoriser un passé créatif régional souvent méconnu.
Des expériences comme celle d’Aïssa Dione permettent de mesurer la hauteur du potentiel africain en termes de création textile. Cela fait plus de vingt-cinq ans que cette Sénégalaise devenue pionnière en la matière a décidé de faire connaître les tissages mandjaques, originaires de Casamance, de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Faisant travailler des tisserands locaux, elle a pu associer le savoir-faire ancestral et le patrimoine local au luxe et à la mode internationale. Ses collaborations avec des maisons de renom comme Hermès, Lacroix, Féraud, sont la preuve de la plausibilité de ce combat mené par elle comme par beaucoup d’autres Africains en faveur du 100 % made in Africa.
PORTRAIT
SALAH BARKA, ENTRE ANTICONFORMISME ET AVANT-GARDISME
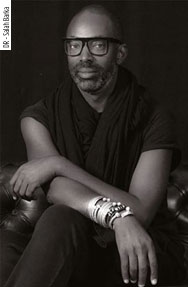 Créateur tunisien passionné par le style ethnique, Salah Barka a lancé grâce à des associations inhabituelles le style arabo-africain, donnant lieu à des collections imprégnées d’originalité mais aussi d’authenticité.
Créateur tunisien passionné par le style ethnique, Salah Barka a lancé grâce à des associations inhabituelles le style arabo-africain, donnant lieu à des collections imprégnées d’originalité mais aussi d’authenticité.
Mais tout n’a pas été simple pour cet autodidacte qui a d’abord fait ses gammes dans le mannequinat. C’est là qu’il côtoie les créateurs et découvre de près un univers pour lequel il se passionne. Mais apprendre les bases du métier a un coût, que peut difficilement se permettre ce cadet d’une famille de neuf frères et soeurs… Il a alors intégré le métier par une autre voie, tout aussi formatrice : le cinéma. Encouragé par de grands stylistes à se lancer, il crée ses propres vêtements et finit par se faire remarquer au point d’être recruté comme assistant-costumier. Une nouvelle étape pour Salah Barka, qui a pu lancer sa propre griffe en s’inspirant de grands créateurs comme Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaulthier ou Vivienne Weswood. Mais son originalité, il la puise en empruntant aux traditions vestimentaires tunisiennes, en allant chercher des détails dans de multiples cultures, qu’elles soient phéniciennes, berbères ou africaines. Il s’intéresse aux modes de vie de différentes ethnies et civilisations, navigue dans les coutumes et traditions et en crée une mode qu’il définit comme « ethnique chic ».
Son métissage des genres fait de lui un alchimiste des couleurs et des matières, plein d’audace et de subtilité. Il aime la mode joyeuse, libérée du carcan social et de « l’effet de séries » imposé par la tendance. Il crée un style non genré pour des hommes qui travaillent leur apparence, tout en ne cachant pas sa préférence pour le « gay style », bien plus ouvert selon lui que ce qu’il nomme le « look vitrine ».
Adepte du « zéro déchet »
À mi-chemin entre l’anticonformisme et l’avant-gardisme, Salah Barka a une touche visible et reconnaissable. Il lance les pantalons unisexes, les vestes pour hommes avec des détails féminins, marie le traditionnel saroual tunisien avec son univers plus éclectique. C’est aussi un adepte du « zéro déchet », qui opte pour la récup’ et déclare préférer les vêtements usés aux neufs. Il aime transformer, patiner, teindre, faire vieillir les matières travaillées et chiner dans les friperies tissus et accessoires auxquels offrir une nouvelle vie.
Fluide, aérien et respectueux de l’environnement, le style de Salah Barka plaît par son aspect épuré au niveau des coupes et des matières mais aussi, bien sûr, par sa forte empreinte africaine. Ses créations ont d’ailleurs été présentées en Afrique lors de divers évènements spécialisés.
Que dire encore de Salah Barka ? Que c’est un homme de principes et de valeurs. On l’a vu dans un documentaire pointant le racisme, ce mal sournois qui ronge la société. C’est aussi un fervent défenseur de la cause homosexuelle, qui milite contre la stigmatisation de la communauté LGBT et les privations de droits que celle-ci subit souvent. Enfin, il prend fait et cause pour les luttes féministes. Pour lui la femme africaine combattante, avec son élégance, son allure ronde ou filiforme, est la muse qui inspire l’homme ethno-chic.