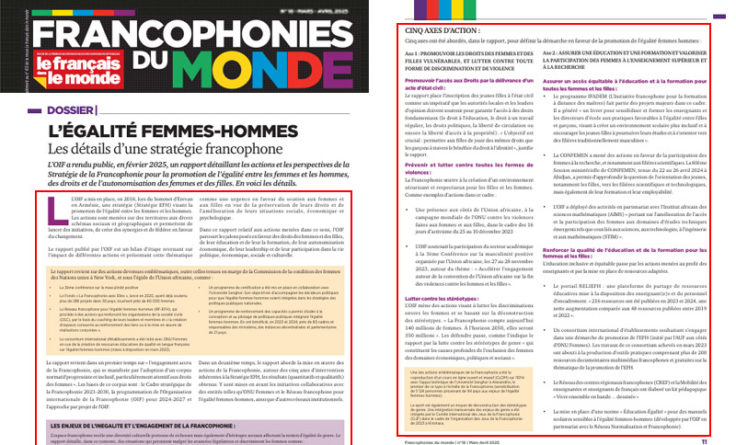Plus de 30 ans que l’Organisation internationale de la Francophonie est aux côtés des cinémas d’Afrique, accompagnant un secteur en pleine mutation grâce notamment à son fonds Image de la Francophonie. Souad Houssein, spécialiste de programme Cinéma à l’OIF, apporte sa lecture de ces trois décennies remplies de changements, d’essais et de succès. Entretien.
Quels sont les traits marquants de plus de 30 ans de soutien du cinéma africain par le Fonds image de la Francophonie ?
J’ai pu observer trois différentes phases dans l’évolution de l’aide au cinéma d’Afrique francophone depuis la création du Fonds Image de l’OIF en 1988. Dans la première phase qui a duré jusqu’en 2006, le cinéma africain francophone dépendait fortement de financements publics bilatéraux et multilatéraux provenant essentiellement du Nord. La seconde phase s’est caractérisée par une certaine érosion de ces financements.
Mais les cinéastes africains se sont adaptés et, en saisissant les possibilités offertes par les technologies du numérique, se sont mis à réaliser leurs films avec de petits budgets. Enfin, la troisième phase est marquée par la multiplication et la diversification des partenaires. Certains États africains ont mis en place des fonds nationaux d’aide à la production. Des partenaires privés se sont intéressés au financement et à la distribution des films africains.
Ce partenariat public/privé a ouvert des nouvelles perspectives au cinéma africain qui attendent d’être mieux explorées.
Le cinéma africain tend-il vers l’universel ? Gagnerait-il à rester identitaire ?
Contrairement à une certaine idée reçue, le cinéma africain ne s’est pas réfugié ou enfermé dans l’affirmation identitaire ou le particularisme culturel. À travers des faits sociaux et des récits africains, il aspire comme tous les cinémas à l’universel, qu’il aborde à partir de son ancrage africain. On dit, d’ailleurs, que « l’universel, c’est le local moins les murs ». D’ailleurs, des films comme Finyé de Souleymane
Cissé (1982), pour ne citer que celui-là, ont eu un succès international non pas parce qu’ils étaient spécifiquement africains mais qu’ils traitaient de thèmes qui pouvaient intéresser le monde entier.
Peut-on parler de renouveau du cinéma africain francophone ?
Oui, car celui-ci s’est déployé ces dernières années à la faveur de l’entrée en scène de partenaires privés internationaux, avec une prise de conscience des États. Ainsi, la production cinématographique des pays d’Afrique francophone est mieux financée, mieux exposée, mieux diffusée et accède progressivement à un marché international. Stabilisé financièrement et plus diversifié dans son contenu, le cinéma africain francophone augmente numériquement et qualitativement – vu, aussi, le nombre de dossiers soumis chaque année au fonds Image de la Francophonie. De même, la cadence de production s’est accélérée : d’un film tous les 5 ou 7 ans, on est passé à 2 ou 3 années. On constate également une africanisation des postes techniques et artistiques.
Quels sont les déclencheurs et les caractéristiques de ce renouveau ?
Grâce aux nouveaux moyens de distribution des films à travers les plateformes numériques, le cinéma africain dispose d’un véritable allié qui lui ouvre un pont direct avec le monde. Ce renouveau est marqué par une large féminisation dans le cinéma africain, ce qui constitue un atout majeur, notamment pour le sortir des stéréotypes. Elles y occupent une place de choix et sont actives à tous les maillons de la chaîne, comme réalisatrices, actrices, maquilleuses, monteuses, mais aussi productrices et directrices de festivals. Les réalisateurs africains, certes moins fortunés, s’appliquent aussi à témoigner de leur temps en multipliant les documentaires.
Ce genre a de beaux jours devant lui, il éduque et incite le public à la prise de conscience citoyenne en donnant un point de vue « interne » à des problématiques autrefois traités par des réalisateurs étrangers.
Quels sont les prochains défis du cinéma africain ?
En tenant compte de l’évolution du paysage et du contexte technologique actuel, les cinémas d’Afrique ont un défi à relever. Les cinéastes africains, conscients de la nécessité de reconquérir leur public, souhaitent rompre avec le « misérabilisme » dans le traitement des scénarios qui avait éloigné le cinéma africain de son public. Par ailleurs, la jeunesse africaine, de plus en plus éduquée et connectée, attend un cinéma qui puisse lui renvoyer une image plus positive de son continent et lui offrir des héros auxquels elle peut s’identifier.
Plus encore, les jeunes Africains attendent que ce cinéma nouveau combatte les préjugés sur l’Afrique, renforce leur confiance et estime de soi, et illustre les contributions significatives des peuples africains au progrès général de l’humanité.