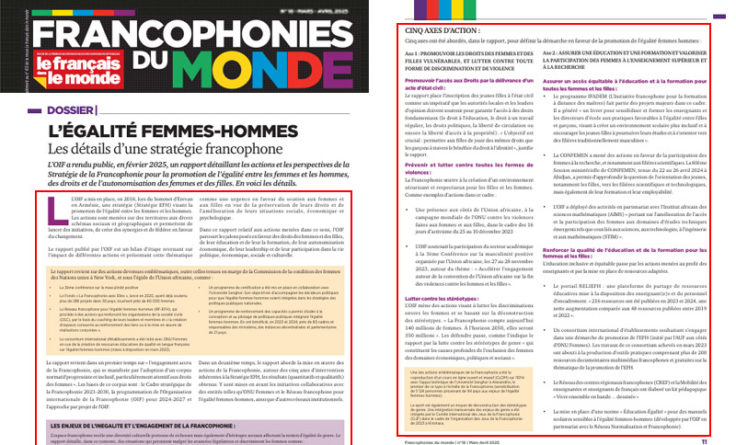PRÉSENTATION DE L’AUTEUR
QUI EST JEAN MALONGA ?
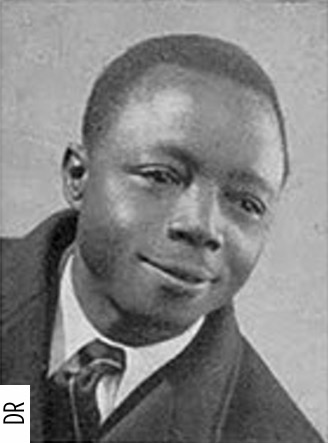 Jean Malonga est né en 1907 à Brazzaville. Il a été parlementaire au Conseil de la république,
Jean Malonga est né en 1907 à Brazzaville. Il a été parlementaire au Conseil de la république,
La chambre haute du Parlement français sous la IVe République. C’est un romancier et conteur qui a su dessiner dans les détails la vie congolaise de son époque et retranscrire les subtilités de son africanité en langue française. Décédé en 1985, Jean Malonga a publié plusieurs ouvrages dont les deux romans Le Coeur d’Aryenne, en 1953, et La Légende de M’Pfoumou Ma Mazono, en 1954.
PRÉSENTATION DE « LA LÉGENDE DE M’PFOUMO MA MAZONO »
L’OEUVRE EN RÉSUMÉ
Dans La Légende de M’Pfoumou Ma Mazono, Malongo dresse le portrait d’un chef, d’un homme libre, à travers le récit de son parcours. Roman initiatique, cette oeuvre évoque les sentiments humains et l’évolution qui, à travers elles, s’opère. Entre réalisme et légendes, mœurs enracinées et rêves de changements, les personnages évoluent et avancent au fil de l’intrigue. Le cadre spatial est esquissé à la manière d’une œuvre picturale emplie de réalisme et chargée de sens. Le cadre temporel ancre, quant à lui, les faits dans une logique de vraisemblance sans failles, à la manière d’un document historique.
LES PERSONNAGES
Dans cet extrait (extrait 1, lire page 32), nous noterons la présence du « je » et du « tu ». Au fil de la discussion, locutrice et interlocuteur se dévoilent : une mère et son fils. Au milieu d’eux, se dresse un mur de conflits opposant leurs genres et que l’on tente, à force d’arguments, d’abolir.
La femme versus l’homme, une opposition argumentée
Tout au long de l’extrait, une mère essaie de prouver à son fils que la femme est l’égale de l’homme, voire lui est supérieure.
Elle réfute, auprès de celui qui incarne à ses yeux la pensée masculine, les arguments selon lesquels la femme serait une « Force inférieure ».
LA FEMME, CETTE DIVINITE !
Telle qu’elle est évoquée par la mère, la femme a les traits d’une divinité. Elle a un pouvoir qui dépasse le champ des possibles. Tout en évoquant ses pouvoirs auprès de l’homme, pour le « consoler » ou le « calmer », la mère fait référence à des capacités d’un autre ordre, grâce auxquelles, la femme « peut bouleverser ou consolider la société la mieux organisée, provoquer ou arrêter des assassinats et des guerres, susciter les héroïsmes les plus sublimes ». Dépassant les capacités humaines, la femme est décrite comme celle dont le pouvoir frôle celui des dieux, tant son action sur le monde qui l’entoure et sur ceux qu’elle côtoie est puissante et surprenante. Elle serait même capable de défier le surnaturel, de le vaincre et d’en détourner les effets. « Elle peut annihiler la puissance de toute la Magie millénaire », dit la mère. « Elle fait disparaître les effets nocifs du venin et du totem les plus redoutables », surenchérit-elle.
La grandeur des capacités féminines est encore plus soulignée car mise côte à côte avec des mots décrivant l’aspect simple de l’action que, d’elle, elles impliquent : « Par son esthétique, sa faiblesse apparente », « par un seul de ses regards, par son sourire ou son mécontentement, d’un seul geste », « Rien qu’avec une imposition de sa petite main », elle génère des actions d’une grandeur inattendue.
Aussi la femme est-elle pourvue d’« attributs créateurs », ajoutant du sublime à sa toute-puissance. « Qu’est-ce qu’il y a de plus divin, de plus grand et de plus beau que de créer ? », demande la mère sans attendre de réponse. « Avoue, mon fils, que la femme a un rôle de premier plan, presque égal à la Force-Suprême », conclut-elle avant de réfuter totalement la thèse évoquée au début de l’extrait : « Non, la femme est autre chose qu’une force inférieure ».
L’HOMME SERAIT-IL LA FORCE INFERIEURE ?
Tout au long du texte, la mère avance des contre-arguments prouvant que la femme n’est pas « une force inférieure », comme le dit une « opinion établie depuis l’origine de la vie ». Afin de mieux asseoir la femme sur son piédestal, la mère ne manque pas de présenter l’homme comme un être inférieur. Il est désigné comme « une épave passive ». Cette passivité est détaillée au moyen de plusieurs situations dont la reproduction humaine où la femme « détient la plus grande responsabilité ». Dans ce contexte, l’homme est évoqué selon son « incapacité génitrice ». Ce n’est pas lui qui est le « foyer de l’oeuf géniteur », ce n’est pas lui qui donne la vie. Il est, en revanche, celui qu’elle fait naître : « engendré et nourri par elle », il « lui doit tout ». Cette « redevabilité » de l’homme vis-vis de la femme place celui-ci au rang de celui qui n’a qu’un « rôle secondaire de soutien dans la famille, le clan ». L’homme, dont la seule action rapportée est qu’il « obéit », est ainsi relégué aux capacités les plus prosaïques. La femme, quant à elle, à la manière des dieux, « conçoit » et « crée ».
 UNE CONFRONTATION RHÉTORIQUE
UNE CONFRONTATION RHÉTORIQUE
Se côtoient, dans ce texte, de nombreuses oppositions accentuant l’ambivalence entre la vision que l’homme a de la femme et les capacités dont celle-ci est pourvue.
L’antithèse « une force inférieure » met l’accent sur ce paradoxe rapporté au moyen d’un argumentaire précédé d’une prétérition qui accentue l’effet des propos et le but qui en est escompté :
« Je n’essayerai pas de te faire changer d’avis. »
L’accumulation permet, également, d’insister sur les caractéristiques féminines : « Qui dit femme, dit Charme, Caresse, Ornement, Fleur, Consolation, Douceur et Paix. » En juxtaposant, à profusion, des termes de la même catégorie grammaticale pour désigner le pouvoir des femmes, la mère crée une forme d’insistance qu’elle appuie par une série d’actions :
« La femme irrite, énerve, excite et calme l’homme. » Enfin, la gradation utilisée dans le cadre de l’emploi des trois premiers verbes est suivie d’une figure d’opposition perceptible à travers les deux verbes coordonnés « excite et calme ».
PRÉSENTATION DE « COEUR D’ARYENNE »
L’OEUVRE EN RÉSUMÉ
Coeur d’Aryenne est le premier texte littéraire de langue française en République du Congo. En précurseur, Jean Malonga y aborde des thèmes que d’autres auteurs ont développés après lui.
L’africanité culturelle, la cohabitation raciale, l’appartenance nationale, le statut de l’opprimé, la tolérance intercommunautaire font la base de la trame romanesque de Coeur d’Aryenne.
Cet ouvrage a été publié en 1953 et il a été réédité, soixante ans après, car considéré comme un livre de référence, témoignage sur une époque, document historique pouvant mieux éclairer l’avenir de la littérature des Afriques.
TROIS PRISES DE PAROLE, TROIS PRISES DE POSITION
Dans le cadre de cet extrait (extrait 2, lire page 32), se côtoient trois prises de parole qui résonnent comme des prises de position autour d’un thème central majeur : la cohabitation interraciale telle que décrite dans le roman de Malonga.
UN NARRATEUR IRONIQUE
Le premier paragraphe correspond à la position du narrateur.
Celui-ci rapporte les propos de deux protagonistes, mais ne manque pas de les commenter, cyniquement. Le narrateur insiste en effet sur le décalage entre les faits et la perception qu’en a le personnage qui refuse que sa fille côtoie un garçon d’une race autre que la sienne.
Ainsi, le fait banal de « laisser deux gamins ensemble » se transforme en acte « invraisemblable », un « grand crime, une atrocité sans nom », un « lèse-humanité aryenne ».
Le narrateur ne manque pas d’insister sur ce décalage en épousant la logique du père pour mieux la décrier. Ainsi, les deux enfants sont évoqués selon leurs couleurs de peau « la Blanche » et « le petit Nègre » ; l’une est décrite comme « une maîtresse » et l’autre comme un « vil objet ».
Quant au père, initiateur de cette vision raciste, le narrateur fait référence à sa bonté en la mettant entre guillemets, pour mieux la contester. Il est désigné, ironiquement, comme « l’apôtre de la fraternité humaine ».
LE RACISME ANCRE
La prise de parole du personnage du père, dans cet extrait, incarne la pensée raciste croyant en la suprématie blanche et appuyant la non-cohabitation entre les races. Monsieur Hux reproche à sa fille d’avoir été en pirogue avec « un petit Nègre tout sale ». L’ami de sa fille est décrit comme un être dangereux, sauvage, « une vermine » pouvant la « contaminer ». Quant à Solange, le père la voit comme « une maîtresse de tous les Nègres ». Le fait de ne pas « garder ses distances » avec son ami est rapporté par le père comme un acte invraisemblable et incompréhensible.
L’ESPOIR DE TOLERANCE
La réponse de la fille aux propos interloqués du père est rapportée comme l’expression « innocente » de la tolérance que celle-ci incarne. Solange défend son ami, met en avant ses qualités, sa fiabilité et son dévouement pour elle. « Il se couperait plutôt la main que de me voir souffrir », ne manque-t-elle pas de déclarer.
L’auteur choisit de faire incarner la cohabitation sereine entre les races et l’annihilation des considérations raciales par le personnage de la fille. Ce choix en dit long sur l’espoir que porte celui-ci quant au changement de mentalités et au renouvellement de l’état d’esprit rétrograde au profit d’une vision plus humaniste des différences.
EXTRAIT 1 LA LÉGENDE DE M’PFOUMOU MA MAZONO
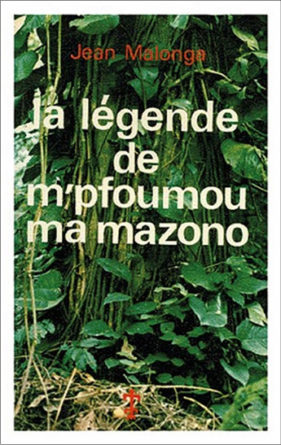 Je constate que toi aussi, comme tous ceux de ton sexe, tu te fais une mauvaise opinion de la femme. Pour les hommes, la femme est une « force » inférieure. Oh ! je n’essayerai pas de te faire changer cette opinion établie depuis l’origine de la vie.
Je constate que toi aussi, comme tous ceux de ton sexe, tu te fais une mauvaise opinion de la femme. Pour les hommes, la femme est une « force » inférieure. Oh ! je n’essayerai pas de te faire changer cette opinion établie depuis l’origine de la vie.
Je voudrais néanmoins te dire ce qu’en réalité nous sommes, nous les femmes dans la société, dans le temps et dans l’espace. Comme tu ne le sais certainement pas encore, je dois t’apprendre que, qui dit femme, dit Charme, Caresse, Ornement, Fleur, Consolation, Douceur et Paix.
La femme irrite, énerve, excite et calme l’homme et le console toujours dans ses moments les plus difficiles. Par son esthétique, sa faiblesse apparente, elle dirige le monde. Par un seul de ses regards, par son sourire ou son mécontentement, d’un seul geste, elle peut bouleverser ou consolider la société la mieux organisée, provoquer ou arrêter des assassinats et des guerres, susciter les héroïsmes les plus sublimes.
Elle peut annihiler la puissance de toute la Magie millénaire. Rien qu’avec une imposition de sa petite main – je ne peux t’en dire davantage – elle fait disparaître les effets nocifs du venin et du totem les plus redoutables. L’homme, épave passive, obéit à toutes ses fantaisies, à toutes ses excentricités.
Tout cela n’est encore rien en comparaison de ses attributs créateurs. Dans la procréation, la femme détient la plus grande responsabilité. L’incapacité génitrice de l’homme disparaît devant sa suprématie, parce que c’est encore elle qui est, généralement, félicitée ou critiquée dans la fécondité ou la stérilité du ménage. N’est-elle pas, en effet, le gîte, le foyer de l’oeuf géniteur ? Mère, elle est incontestablement l’agent intermédiaire entre « la Force Suprême » et la création. L’homme, lui, encore une fois, n’est ici que d’un apport secondaire pour la multiplication du genre humain. Qu’est-ce qu’il y a de plus divin, de plus grand et de plus beau que de créer ? La femme conçoit, ou si tu préfères elle crée en quelque sorte.
Pendant neuf mois, elle porte dans son sein, nourrit de son sang et de sa chaleur le foetus qui, une fois né, aura encore besoin de sa tendresse, de son lait, de ses soins les plus sublimes.
Avoue, mon fils, que la femme a un rôle de premier plan, presque égal à la « Force Suprême ». Pourquoi dans ces conditions, l’homme engendré et nourri par elle, qui lui doit tout, qui n’a qu’un rôle secondaire de soutien dans la famille, le clan, la traite-t-il en être insignifiant et inférieur ? Non la femme est autre chose qu’une force inférieure.
EXTRAIT 2 COEUR D’ARYENNE
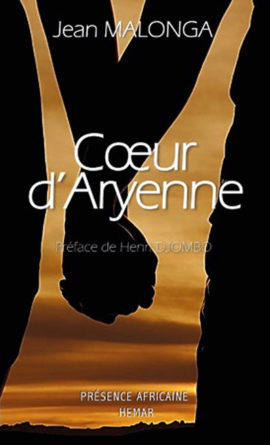 Il paraît que cette insouciance invraisemblable de laisser deux enfants, deux gamins ensemble, surtout de race différente – une Blanche, c’est-à-dire une maîtresse, et un petit Nègre qui n’est autre chose qu’un vil objet – était un grand crime, une atrocité sans nom aux yeux du « bon » Père Hux. Comme cela se devait, il avait d’abord fait un sermon sentencieux à Solange, puni sévèrement Mambeké et averti les parents inconscients et coupables de ce lèse-humanité aryenne.
Il paraît que cette insouciance invraisemblable de laisser deux enfants, deux gamins ensemble, surtout de race différente – une Blanche, c’est-à-dire une maîtresse, et un petit Nègre qui n’est autre chose qu’un vil objet – était un grand crime, une atrocité sans nom aux yeux du « bon » Père Hux. Comme cela se devait, il avait d’abord fait un sermon sentencieux à Solange, puni sévèrement Mambeké et averti les parents inconscients et coupables de ce lèse-humanité aryenne.
— Ma petite Solange, avait susurré l’apôtre de la fraternité humaine. Ma petite Solange, mais tu es extraordinaire. Comment oses-tu te faire conduire en pirogue par un petit Nègre tout sale ? N’as-tu pas peur de te voir jeter à l’eau par ce sauvage qui se régalera ensuite de ta chair si tendre ? N’as-tu pas peur de te contaminer de sa vermine ? Je ne te comprends pas, mon enfant.
Non, réellement, je ne peux pas arriver à te comprendre. Oublies-tu donc que tu es une Blanche, une maîtresse pour tous les Nègres, quels qu’ils soient ? Il faut savoir garder ses distances, que diable !
— Mais mon Père, avait essayé de protester l’innocente Solange. Mais, mon Père, Mambeké est un garçon très habile. Il manie la pagaie mieux que tous ceux de la factorerie. En outre, il est poli, correct, discipliné et ne m’a jamais rien dit de méchant. Il se couperait plutôt la main que de me voir souffrir. Je m’amuse énormément à son bord.