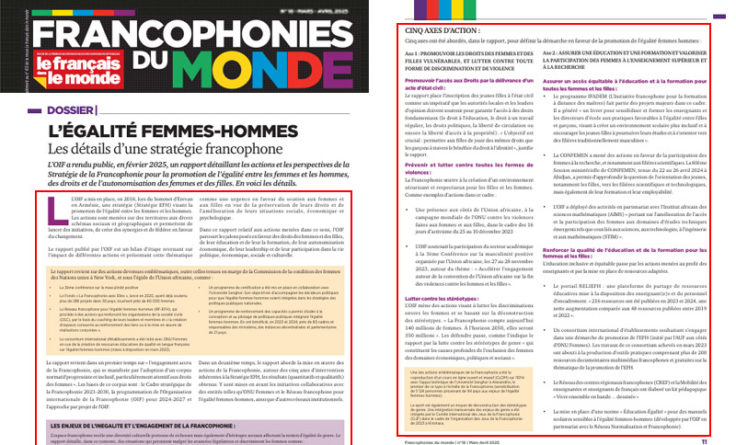Le ndop est une étoffe bleu indigo avec des motifs blancs fabriquée depuis plusieurs siècles dans le nord du Cameroun. Connu pour sa méthode de production artisanale et élaborée, ce tissu noble a évolué au fil des ans, passant des plateaux volcaniques des peuples bamilékés aux grandes maisons de couture.
On lie souvent l’Afrique au wax, mais le travail des tissus a toujours été sur le continent un savoir-faire ancestral et emblématique, une des composantes essentielles du patrimoine culturel de certains peuples et pays. C’est le cas pour le tissu ndop, dans la fabrication duquel s’illustre le nord du Cameroun.
Les premières traces de cette étoffe remontent au xve siècle, et c’est au xviiie siècle qu’il a été développé. Plus particulièrement ce sont les Bamilékés et les Bamouns, deux peuples des hauts plateaux volcaniques de l’ouest du pays (et proches par des ancêtres communs et des pratiques similaires) qui sont connus pour leur savoir-faire et la fabrication de ce tissu très particulier. Le tissu ndop est fabriqué par la mise côte à côte de bandes de coton bleu indigo ornées de motifs blancs géométriques ou figuratifs (avec des représentations de plantes ou d’animaux).
Avant de voyager vers l’ouest du pays pour les travaux de surcouture et de finition, il se tisse et trouve sa couleur définitive dans le nord du Cameroun, dans la région de Garoua. Un filage à la main, pratiqué souvent en groupe, permet aux artisans de produire la première étape d’un parcours long et précis, le tissage s’effectuant ensuite sur des métiers de petite taille, avant l’ajout par les tisserands des motifs géométriques emblématiques du ndop. Ces formes sont aussi symboliques car elles représentent souvent la relation de l’homme avec la nature et l’au-delà.
Elles sont en cela porteuses de signification et objet de multiples interprétations. La technique la plus ancienne se faisait au moyen d’un fil de raphia que l’on positionnait en surcouture avant de teindre le tissu. Un moyen pour obtenir des motifs en blanc, une fois le fil retiré. Une méthode fastidieuse qui a été remplacée par une autre qui consiste en l’utilisation d’une matière imperméable, la cire de bougie ou une pâte faite à partir du manioc, par exemple.
Une fois le travail de surcouture achevé, l’étoffe est plongée dans une teinture bleu indigo. Le contraste qui se crée grâce à « la technique de la réserve » permet ainsi de laisser apparaître des motifs blancs. Il existe également une variante de ndop présentant des motifs brodés à la main.
Du sacré au tendance
Le ndop était autrefois considéré comme un produit local chargé de valeur, qui s’offrait dans le cadre d’échanges et de transactions entre peuples et entre chefs, en signe d’amitié et de paix.
Cette noble étoffe se transmettait d’une génération à l’autre dans le cadre de rites initiatiques. Seuls d’éminents membres, souvent appartenant à des sociétés secrètes, pouvaient l’arborer, les décorations et la matière du tissu, hautement symboliques, variant selon la région et la famille.
Grâce à des pratiques nouvelles et moins élaborées, il a progressivement été possible de rendre le tissu ndop plus accessible. À côté de la forme originelle produite exclusivement à la main par des artisans confirmés, il existe un autre type dit semi-artisanal, fabriqué à base d’un tissu industriel traité ensuite artisanalement. Mais il existe aussi une variante entièrement industrielle. Malgré l’attachement qu’elles vouent aux formes, aux couleurs, aux motifs, ces deux versions sont perçues de manière péjorative car noyant le marché de « pâles copies ».
 Au fil des années, le ndop a perdu sa valeur symbolique et son aspect sacré, mais son industrialisation a permis d’en faire une tendance connue à l’échelle internationale. Aujourd’hui, ce tissu a permis la mise en avant du patrimoine culturel camerounais, notamment grâce à des créateurs qui l’ont utilisé d’une manière innovante, tel Cédric DeBakey, qui en a fait des accessoires de mode.
Au fil des années, le ndop a perdu sa valeur symbolique et son aspect sacré, mais son industrialisation a permis d’en faire une tendance connue à l’échelle internationale. Aujourd’hui, ce tissu a permis la mise en avant du patrimoine culturel camerounais, notamment grâce à des créateurs qui l’ont utilisé d’une manière innovante, tel Cédric DeBakey, qui en a fait des accessoires de mode.
Le ndop a même inspiré les plus grandes maisons de couture comme Hermès, de telle sorte que de ce tissu ancestral des Bamilékés est née une collection de foulards en soie vendus partout sur la planète.